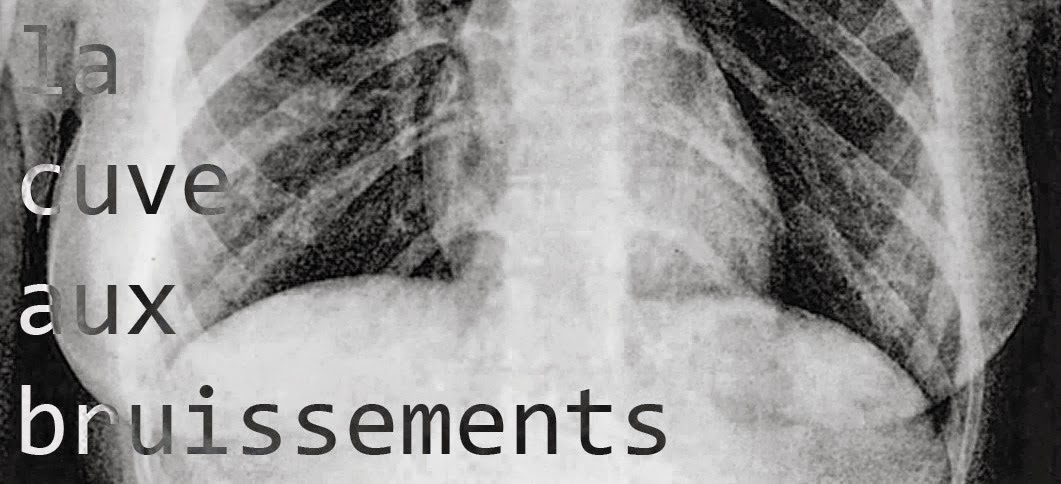I
Le retour
La nuit tombe. C'est la fin de l'été. L'odeur du soleil couchant et de l'urine sèche baille entre les rues, se faufile entre les lampadaires, remonte le long des murs. Sur les pentes, la fenêtre est grand ouverte. C'est au quatrième. Elle est assise par terre, le dos contre le mur à côté de la fenêtre, et fume longuement sa cigarette en attendant l'obscurité. La peau contre le parquet tiède, elle ressent cette nostalgie voilée qu'apportent les nuits après les grandes chaleurs.
Il arrive. Elle l'entend grimper lourdement les étages impossibles. Elle ne l'attend plus. Tout ce qu'elle veut à cet instant précis c'est qu'en ouvrant la porte il laisse entrer la fraîcheur de l'air enfermé dans la cage d'escalier, cet air englouti dans le ventre poussiéreux du vieux monde. Et puis le verrou tourne. Il ouvre la porte. Elle ne le regarde pas, elle ne bouge pas. Il reste sur le palier pendant quelques instants qui installent le silence dans la pièce, un silence blanc, vide, un silence qui ne cherche pas à être trouvé.
Muet, à peine perceptible, un courant d'air frais se faufile dans la pièce et arrive jusqu'à ses pieds nus. Elle les regarde. Elle ne bouge pas.
— Salut.
Sa voix semble essoufflée, épongée, démunie de sa masculinité habituelle, comme si ces deux syllabes avaient péniblement traversé le temps pour arriver à l'autre bout de la pièce.
Elle tourne la tête vers lui. Il n'a pas maigri. Ses cheveux sont plus courts. Sa barbe semble mieux entretenue qu'avant. Il a toujours les mêmes chaussures, mais à première vue on ne dirait pas qu'elles ont voyagé tant que ça. Il a posé son sac à dos à moitié ouvert à ses pieds. Une délicate poudre blanche s'échappe par l'ouverture et tombe lentement, légère comme de la neige, sur le tapis rouge de l'entrée.
— Fais gaffe, il y a un truc qui sort de ton sac, dit-elle en pointant du doigt le petit tas blanc sur rouge.
Il ne le regarde pas. Il a son regard fixé sur elle. Elle le sent, il le sait. Mais elle ne veut pas le regarder dans les yeux, à quoi bon ? Tant de force et si peu d'intention.
— Ça s'est ouvert sur le chemin, ne t'en fais pas.
Elle regarde la poudre s'accumuler lentement, formant un tas toujours plus grand. Puis elle regarde la porte, grand ouverte. Elle aimerait qu'elle soit fermée. Elle aimerait se lever et se laisser aspirer par le souffle de la cage d'escalier et que cette porte se referme derrière elle.
— Ferme la porte, s'il te plaît.
— Tu ne vas pas te lever ?
— S'il te plaît...
— Tu m'attendais.
— Je ne te cherche plus. Ferme la porte.
— Tu me cherchais. C'est pour ça que tu m'attends. Pourquoi t'es là, sinon?
— C'est toi qui es venu, je te l'ai pas demandé. Ferme la porte.
Pendant qu'il se retourne pour la refermer, elle se lève. Elle remarque alors que quelques petits grains blancs, poussés par le courant d'air, sont arrivés tout près d'elle.
C'est de la coke.
Ils se regardent, droit dans les yeux.
— Je le savais, dit-elle. Et tu n'aurais pas dû revenir.
Sans la quitter des yeux, il ouvre brusquement son sac. Et la poudre tombe. Elle s'échappe par flots, à l'infini, recouvrant le sol, remontant vertigineusement les murs jusqu'à engloutir la pièce, qui disparaît sous ses yeux.
II
La clôture
Le cœur à toute allure, retenant son souffle, elle se débat lourdement pendant quelques secondes, avant d'être saisie d'une énorme fatigue. C'est une fatigue de l'esprit, du cœur, une lassitude au delà de la résignation, une lassitude qu'elle a endurée seule, dans la passivité, dans l'attente. Un sentiment qui l'a accompagnée pendant longtemps et qui l'envahissait avec le souvenir de leur histoire, de son départ.
Ensevelie sous la marée blanche, immergée dans le silence, elle essaye de réfléchir. Son cœur bat encoure vigoureusement dans sa poitrine, accéléré par la peur et l'adrénaline. La poudre autour d'elle a cessé de s'accumuler, laissant place à un silence sourd, invariable, sans aucun mouvement. C'est alors qu'elle le comprend. Le vent. Un courant d'air. La porte. Il faudra la rouvrir pour une dernière fois.
Enterrée sous la poudre compacte, elle sait bien que ce n'est pas avec son corps qu'elle atteindra la poignée. Cet engouffrement n'est autre chose que les restes de son propre attachement, l'écroulement de ses espoirs construits. Elle garde le silence pendant quelques instants.
« Je renonce ».
Avec un ronflement impétueux, la poudre autour d'elle est balayée par un énorme coup de vent. Elle se retrouve nue, debout sur une vaste étendue blanche, lisse et uniforme, un désert de cocaïne. Sur sa tête, le ciel jaunâtre est lourd et sourd, le sol brûlant sous ses pieds. Sur une petite colline jaillie de nulle part, à une centaine de mètres, elle aperçoit sa silhouette qui lui tourne le dos.
Elle avance vers lui d'un pas lent mais assuré. En s'approchant, elle réalise qu'il n'est pas seul. Une femme pâle est apparue à ses côtés, nue elle aussi, avec de longs cheveux blonds qui lui tombent jusqu'aux hanches. Il la tient fermement contre lui, pressant d'une main sa tête contre la sienne, embrassant sa bouche pulpeuse et tendre avec une vigueur farouche. Il lève son regard pour la fixer tandis qu'elle continue de s'avancer vers lui. Arrivée au pied du monticule, elle se rend compte que la peau de la blonde est entièrement recouverte de coke. Comme s'il s'en était aperçu au même moment, il arrête de l'embrasser et commence à lécher son cou, ses seins, son nombril, avec l'avidité d'un animal affamé. Une fois qu'il a minutieusement parcouru toute sa peau de sa langue, il la repousse brusquement et elle dévale le long de la pente, roulant comme un tas de viande morte jusqu'à ses pieds. Elle reste sur place, le cadavre aux grands yeux bleus devant elle, sans le quitter des yeux.
Il s'accroupit et plonge son bras par terre, puis le relève d'un geste violent. Il tient une autre femme par les cheveux, qu'il déterre comme une carotte. Celle-ci est brune, et, comme celle d'avant, a une longue chevelure qui lui couvre le dos. Sans tarder, il procède frénétiquement à enlever jusqu'à la dernière graine la coke de son corps, lèche ses mains, ses cuisses, son sexe. Puis il la pousse, et en déterre une autre.
Elle regarde la scène se répéter sous ses yeux sans dire un mot, sans le quitter du regard. La blonde et la brune sont toujours à ses pieds, inertes et vides. Puis la rousse arrive. Et une autre blonde. L'odeur de ces corps remonte à ses narines, une odeur à lui, à ses propres entrailles. Une forte répulsion lui presse l'estomac, un dégoût qui s'étend, qui lui cloue les pieds au sol, qui remonte le long de son œsophage. Sur la colline, les femmes surgissent à l'infini. Elle fait tout pour se retenir, pour contrôler son corps, mais les larmes se frayent un chemin et tombent silencieusement le long de ses joues. Elle ferme les yeux.
Quand elle les rouvre, une nouvelle femme est apparue à ses pieds. C'est elle. Elle la regarde, elle se regarde dans ce miroir macabre. La peau lisse garde les traces du passage de sa langue et émane la même odeur que les autres. Son regard, vide, est dirigé vers lui, arrêté sur son sommet.
« Je renonce », répète-t-elle, sa voix perdue au milieu de la douleur et de l'effroi. Elle a compris maintenant.
Elle se penche lentement sur son corps, et le soulève dans ses bras. Elle est étonnamment légère et tiède. Elle approche ses lèvres des lèvres de cette coquille vide et les pose dessus avec tendresse. Elle le regarde droit dans les yeux, ferme et sincère, et prend une grande inspiration.
Puis, à pleine dents, elle croque dans la chair de ce qu'elle était. Et il ne reste que le vent.